Il apparaît aujourd’hui évident que pour garantir la poursuite de notre vie sur terre, il faudra renoncer à un certain nombre de choses. Mais lesquelles? Et comment les déterminer? Il y a quelques semaines, le professeur et philosophe français Alexandre Monnin, auteur de Politiser le renoncement, paru en 2023, était de passage à Montréal.
Nous l’avons rencontré afin de mieux comprendre sa théorie de la « redirection écologique », qu’il distingue notamment de la transition et de la décroissance.
Vous êtes professeur à l’ESC Clermont Business School, une école de gestion. On pourrait croire que « redirection écologique » et science de la gestion ne vont pas bien ensemble?
Alexandre Monnin : L’école de management peut effectivement être vue comme renforçant le « business as usual ». Par contre, ce sont aussi des lieux où on va réfléchir à l’organisation, à l’entrepreneuriat, aux chaînes logistiques, bref, plein de choses qui auront un rôle crucial pour les changements nécessaires.
La formation que je dirige est imbriquée dans une école de management, mais aussi de design. Ce n’est pas anodin. L’aspect design permet de surpasser le management traditionnel : on fait des enquêtes, on travaille sur des matériaux empiriques, on réfléchit sur les formes. Donc c’est l’union du management et du design.
Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par « redirection » et en quoi cela se différencie de la transition écologique?
Alexandre Monnin : L’idée était de radicaliser la notion de transition écologique, la rendre plus urgente.
Le terme « redirection écologique » est emprunté au théoricien du design australien Tony Fry. Il sous-entend l’existence d’un héritage qu’on ne peut négliger, mais dont on va essayer de faire autre chose.
La redirection nous dit qu’on ne pourra pas tout maintenir, que le monde change et que les environnements futurs ne nous permettront pas de poursuivre les activités d’aujourd’hui. On va devoir mettre fin à un certain nombre de choses.
En France, par exemple, nous aurons à affronter cette problématique autour des stations de ski. On sait qu’il n’y aura pas de la neige pour toujours et il apparaît aujourd’hui évident qu’il va falloir fermer plusieurs de ces entreprises.
La redirection écologique étudie ce qui se passe après la fermeture : que faire de ces infrastructures, quelles activités peuvent être mises en place et comment minimiser les impacts négatifs sur les personnes touchées? Idéalement, on veut pouvoir voir venir ces fermetures et ces démantèlements pour les planifier plus en douceur, pour qu’elles soient moins brutales pour les personnes qui les subissent, comme les employé·es et les habitant·es des secteurs touchés. Les stations de ski peuvent proposer des activités quatre saisons, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour soutenir leurs infrastructures. Elles ont peut-être une réflexion à mener à l’échelle de leur industrie.
C’est plus qu’un travail d’élaboration théorique.
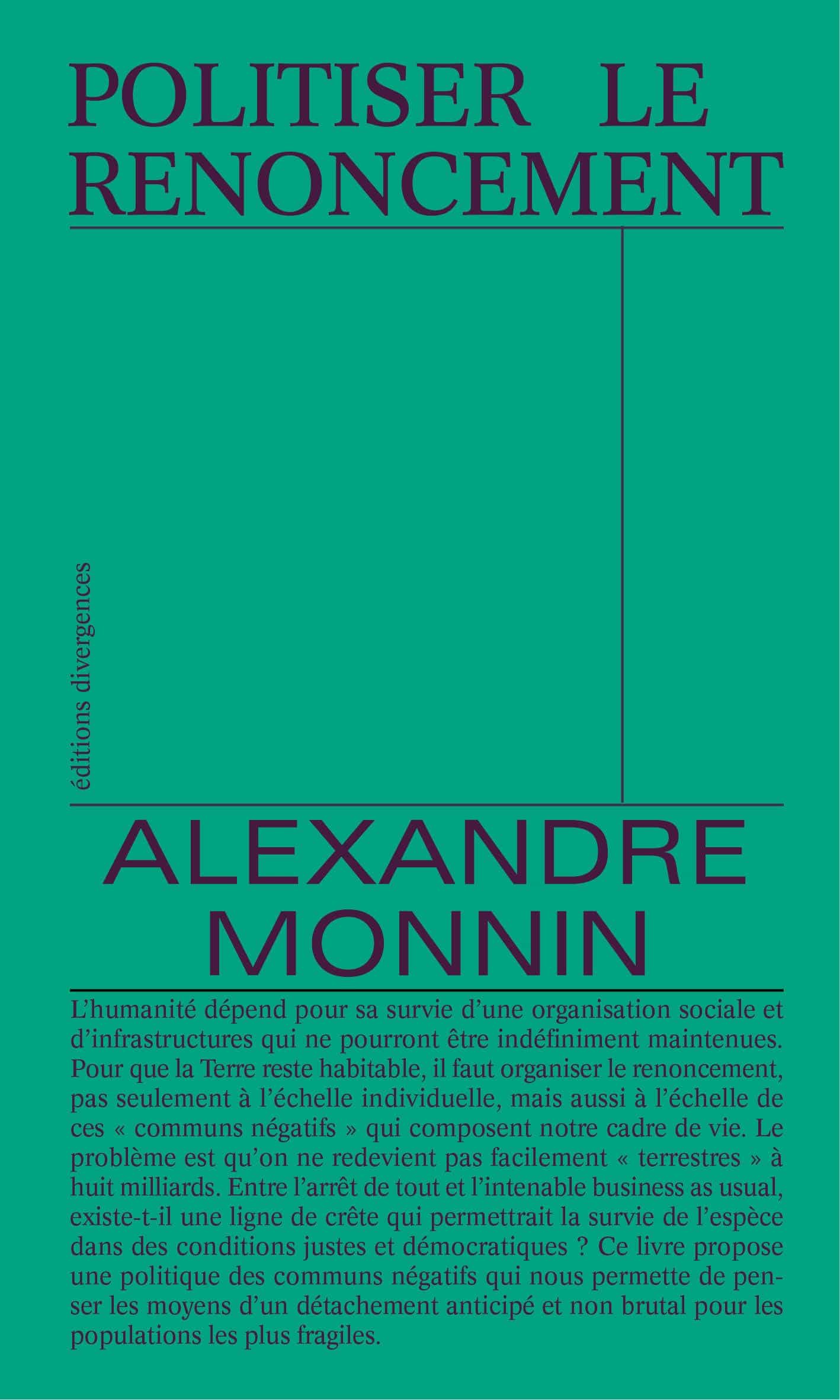
Et en quoi la redirection diffère-t-elle de la décroissance, qui valorise elle aussi la fermeture de plusieurs composantes de la société actuelle?
Alexandre Monnin : La décroissance est un concept macro-économique qui élabore une planification des façons de vivre demain. Par contre, dans les travaux sur la décroissance que j’ai lus jusqu’à présent, j’ai du mal à voir comment on s’y rend, à ce monde de demain.
Nous sommes déjà confrontés au renoncement, il est donc urgent de trouver la meilleure façon de s’y attaquer.
« On va devoir mettre fin à un certain nombre de choses. »
Je donne l’exemple de ce qui se passe au Québec avec la pêche à la crevette de Matane [dont la plus grosse usine, Les Fruits de mer de l’Est, a fermé ses portes au mois de mars]. De nombreux emplois sont perdus. La redirection va prendre comme objet d’étude ce type de situation, très concrète et réelle. Comment s’assurer que lorsque ces fermetures surviennent, ce ne sont pas les plus vulnérables qui payent le plus gros prix?
Dans la redirection, on va enquêter sur le terrain auprès des gens concernés pour comprendre quels sont leurs attachements aux activités, aux infrastructures, aux territoires qui seront amenés à se transformer. On cherche à documenter les impacts de ces fermetures. De quoi les gens vont-ils vivre? Qu’est-ce qui se passe si mon métier est affecté? C’est la prise en compte de tous ces facteurs pour tenter d’identifier de quelles activités on aura besoin demain.
Donc on est moins dans l’atteinte d’un horizon tel que pensé par un petit groupe d’universitaires. On peut bien dire aux gens de ne pas prendre leur voiture, mais si vous habitez en périphérie et qu’il n’y a pas de transport en commun, vous faites comment?
Une des notions mobilisées dans Politiser le renoncement est l’attachement. De quoi s’agit-il?
Alexandre Monnin : Le sociologue français Antoine Hennion définit l’attachement comme ce à quoi on tient et ce qui nous tient, c’est-à-dire autant ce qu’on valorise sur le plan affectif que ce à quoi on se lie volontairement ou non. Je suis lié à des infrastructures, à un travail, à des choses dont j’ai besoin pour subsister – comme ma voiture, dans le cas des personnes vivant en périphéries. C’est ce sans quoi on ne peut pas faire.
Dans une situation où la viabilité d’une infrastructure, d’une activité, d’un territoire ou autre, est remise en question, la première étape dans une optique de redirection écologique est de comprendre les attachements en jeu. Si quelque chose doit disparaître, on doit aller voir comment les personnes seront affectées. Évaluer les différents attachements permet de prendre des décisions de renoncement éclairées.
Je prends l’exemple de la crise des Gilets jaunes, en France. Cette crise a démarré avec l’instauration d’une écotaxe sur l’essence par le gouvernement, qui disait vouloir en faire diminuer la consommation. Les personnes qui vivent en zones périurbaines ont un attachement direct et involontaire à la voiture : c’est parce que les infrastructures de ces zones reposent sur la centralité de la voiture qu’on en dépend. Donc, non seulement je suis obligé de prendre ma voiture, mais vous rendez ça plus pénible encore! On a bien vu la réaction que ça a engendrée.
« Évaluer les différents attachements permet de prendre des décisions de renoncement éclairées. »
Donc on a tout intérêt à maîtriser et connaître ces attachements, car certaines personnes ne sont pas en mesure de renoncer à certaines choses. La redirection va donc chercher à identifier ce qu’on doit conserver et ce que l’on peut abandonner et modifier.
Dans le cas où différents attachements entreraient en conflit, comment fait-on pour déterminer lesquels l’emporteraient?
Alexandre Monnin : En effet, comment tranche-t-on? Pour cela, il faudra également penser les dés-attachements. Je ne dis pas « détachement », qui est de se placer au-dessus des choses terrestres, comme dans le bouddhisme. Je veux plutôt parler de mettre au point des méthodologies, des protocoles et des processus démocratiques pour faciliter ce choix. De quoi peut-on se passer, collectivement?
« Idéalement, on choisirait en privilégiant les plus vulnérables. »
Dans les cas où il faudra trancher, le travail sur les attachements permettra de voir venir où se situera le conflit, qui va forcément survenir. Mais au moins, on aura saisi toutes les nuances de la situation. Si on tranche sans bien comprendre, ça risque d’être maladroit, de créer des blessures à vif. Et là, le conflit sera inéluctable.
Dans le choix à faire, idéalement, on le ferait en privilégiant les plus vulnérables. C’est pour cela que la redirection écologique n’est pas axée que sur la viabilité environnementale, mais sociale également. Les choses qu’on va éliminer, ce sera aussi parce qu’elles sont génératrices d’inégalités.